Les plantes
sauvages de La Lande Chasles
ACCES
TABLEAU / Lien web
Ce travail a permis à
la commune de La Lande-Chasles d'être nominée à la 30e édition des
trophées ECO ACTIONS

Arrêté préfectoral du 28 avril 2021 /
Téléchargement PDF
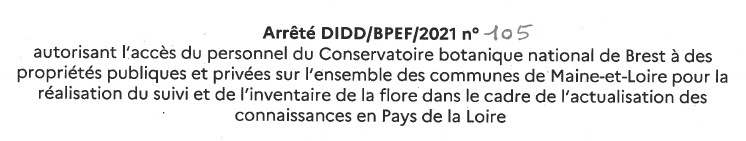
Pour aller plus loin : Cliquer
ICI pour accéder au site du conservatoire de Brest
La Lande Chasles, plus
petite commune du Maine et Loire, profite d’un cadre naturel privilégié.
Elle propose diverses promenades tranquilles, dont un circuit pédestre
balisé le long duquel les randonneurs pourront rechercher les nombreux
types de plantes qui le bordent (plus de 400 !), et aussi observer la
faune. Depuis 2022, la commune s’est engagée dans une politique de
fauchage raisonné de ses bords de routes et chemins municipaux, dans le
but de mieux protéger son patrimoine botanique. Du fait de la grande
variété de plantes, de nombreux insectes, en particulier, peuvent être
admirés.
Pour vous aider dans
l’identification des plantes de notre territoire, nous vous proposons un
ensemble de fiches, toutes conçues sur le même modèle, et correspondant
à des plantes réellement présentes sur les terrains appartenant à la
commune, en particuliers bords de chemins et de routes… Nous nous
limiterons dans un premier temps aux plantes « sauvages » (même si
certaines de celles-ci sont parfois peu spectaculaires). Nous ne
parlerons, au moins dans un premier temps, ni des champignons, mousses,
lichens, ni des plantes cultivées, également observables lors de vos
promenades.
Pour chaque fiche, vous trouverez :
-
En haut à gauche, la ou les saison(s) de floraison :
o
Printemps (P, en vert),
o
été (E, en jaune),
o
Automne (A, en brun),
o
Hiver (H, en blanc).
-
En haut à droite, la couleur dominante des fleurs symbolisée par une
petite fleur :
o
{ Fleurs blanches,
o
| Fleurs jaunes, jaunâtres ou orangées,
o
| Fleurs rouges, roses ou
pourpres,
o
| Fleurs bleues, mauves, violettes ou
bleu pourpre,
o
| Fleurs brunes ou brunâtres,
o
| Fleurs vertes ou verdâtres.
o
X
Plante sans
fleur
-
Puis l’identité de la plante avec sa famille,
son nom latin (avec une majuscule pour le nom de genre, une minuscule
pour le nom d’espèce), son nom français, avec éventuellement d’autres
noms courants. Attention : la classification des végétaux est en
constante évolution. Nous avons choisi d’indiquer les familles suivant
la classification de Arthur John Cronquist, officialisée en 1981, qui
utilise les ressemblances anatomiques et les particularités
fonctionnelles pour créer des groupes et des familles à partir du nom
latin d’une plante considérée comme « de référence ». L'avantage, c'est
que les groupes ainsi formés sont relativement simples à identifier. Par
exemple, toutes les plantes de la famille des astéracées, qui ont pour
modèle de base l’Aster, sont « fabriquées » sur le même modèle : un
« support » sur lequel sont installées des tas de « mini-fleurs » dont
l’ensemble (le capitule) donne l’impression d’une seule fleur (cas
également de la marguerite, du pissenlit…). Nous indiquerons aussi entre
parenthèses le nom de famille correspondant de la classification de
Linné, dite binomiale, basée sur les particularités anatomiques et
chimiques des fleurs, et parfois mieux connue. Ainsi, pour reprendre
l’exemple précédent, les Astéracées, dans la classification de Linné,
sont dans la famille des « composées », car ce qu’on croit être la fleur
est en fait composé d’une multitude de « mini-fleurs ». Par contre, nous
ne parlerons pas de la dernière réforme de 2009 qui est aujourd'hui le
système le plus abouti et reconnu, qui utilise microscopie
électronique, génétique, biologie moléculaire... C’est la classification
phylogénétique de l’APG, peu utilisable à notre niveau.
-
Certains des lieux où nous avons trouvé cette plante sur la
commune de La Lande Chasles (mais ce n’est évidemment pas une garantie
de les retrouver chaque année à ce même emplacement : d’une année sur
l’autre, certaines plantes peuvent disparaitre d’un endroit pour
diverses raisons (passage d’un véhicule lourd qui a écrasé la plante et
trop tassé la terre, passage de tondeuse trop fréquent et trop ras,
modification des conditions de croissance comme sécheresse ou au
contraire humidité trop importante, température trop élevée ou trop
faible….)
-
Des particularités éventuelles, qui peuvent aider à
l’identification, ou permettre de faciliter la différenciation avec une
autre plante proche.
-
Eventuellement quelques photos complémentaires.
Ces fiches sont répertoriées dans un tableau
regroupant divers critères :
-
la famille,
-
le nom latin,
-
le nom français
-
la couleur de fleurs (mêmes critères de couleur que pour les
fiches bien sûr, avec une lettre associée pour permettre les tris :
blanc (W), jaune (J) rouge (R), bleu (B), marron (M), vert (V), sans
fleur (X).
-
les mois de floraison habituels
-
les saisons de floraison habituelles : printemps (P, en vert :
mars, avril, mai), été (E, en jaune : juin, juillet, août), automne (A,
en brun : septembre, octobre, novembre), hiver (H, en blanc : décembre,
janvier, février).
-
s’il s’agit ou non de plantes mellifères,
-
s’il s’agit ou non de médicinales,
-
s’il s’agit ou non de plantes toxiques.
Pour faciliter vos recherches, dans le tableau, les
plantes sont classées par couleur de fleur, car c’est le premier point
que l’on remarque en général, et pour chaque couleur, par ordre
alphabétique des noms français.
Un lien pourra vous envoyer directement sur la
fiche concernée. Vous trouverez en annexe un petit lexique pour
expliquer certains des termes que nous avons utilisés.
Des compléments ou mises
à jour pourront avoir lieu périodiquement. N’hésitez pas non plus à nous
signaler des plantes nouvelles, en nous envoyant si possible des photos
de la plante entière, des feuilles et des fleurs, accompagnées de
l’indication du lieu où vous les avez rencontrées sur le territoire de
La Lande Chasles.
ACCES
TABLEAU / Lien web
PRECISIONS IMPORTANTES :
Ces fiches ne
constituent pas une flore, et donc ne permettent pas d’identifier de
façon certaine des espèces proches. Pour cela, il faut se reporter à des
ouvrages spécialisés. Elles ont pour seule ambition de vous faire
découvrir la richesse du milieu naturel de notre petite commune.
Malgré toutes nos
précautions, il est possible qu’il puisse y avoir des erreurs
d’identification. Vous voudrez bien nous en excuser : si nous sommes
très intéressés par les plantes, nous ne sommes néanmoins pas botanistes
professionnels.
Merci de ne pas cueillir ces fleurs ou plantes
: elles pourront ainsi être à nouveau visibles lors de vos
prochaines sorties. Il va de soi qu’elles ne
doivent pas non plus être consommées :
une erreur d’identification (comme entre la carotte sauvage, le cerfeuil
penché, et la ciguë par exemple) peut vite devenir problématique…. Et
même mortelle.
Bonne promenade !
Martine COULON & Gilles POIRIER
NB : le numéro à droite de chaque photo indique son
origine :
1 Photo personnelle (Gilles Poirier, Martine Coulon)
2 Photo du site
https://www.tela-botanica.org/
3 Photo du site
https://inpn.mnhn.fr/
4 Photo du site https://www.preservons-la-nature.fr/flore/
5 Photo du site http://abiris.snv.jussieu.fr/flore
6 Photo du site http://herbierdicietdailleurs.eklablog.com/
7 Photo du site
http://fauneetfloredefrance.eklablog.fr/
8 Photo du site https://www.sauvagesdupoitou.com/
9 Photo du site
https://canope.ac-besancon.fr/flore/
10 Photo de site
https://quelle-est-cette-fleur.com/
Quelques termes
expliqués
Dans les fiches que nous
vous proposons, nous avons privilégié le repérage direct des plantes par
leur aspect visuel plutôt que par des déterminations botaniques qui
auraient nécessité un vocabulaire précis. Néanmoins, nous avons dû
utiliser quelques termes qui ne sont pas forcément bien connus de tous,
lors de la description des plantes, afin de limiter les risques de
confusion. Vous les trouverez ci-dessous, par ordre alphabétique.
- Annuelle :
c’est une plante qui ne vit que pendant une saison, voire moins.
Résultat : elle va la plupart du temps se multiplier par ses graines,
qui attendront sur ou dans le sol des conditions favorables pour germer.
En conséquence si elle est fauchée précocement, elle n’aura pas le temps
de faire mûrir ses graines. Il se peut qu’il en reste d’années
précédentes, ce qui permettra sa réapparition. Les graines étant
déplacées par le vent, le ruissellement ou les animaux, on ne retrouve
pas forcément la plante au même endroit chaque année.
- Bisannuelle :
Elle vit pendant 2 saisons successives. La première, elle germe et fait
des feuilles, souvent en rosette. La seconde, elle grossit et fleurit,
fait des graines, puis meurt.
- Bractée :
c’est un genre de petite feuille ou d’écaille située au voisinage
immédiat des fleurs. Elles peuvent être utiles pour différencier 2
plantes (voir par exemple la fiche de la carotte sauvage)
- Capitule :
ce qui paraît être une fleur unique est en réalité un amas de
mini-fleurs, regroupées sur un plateau. Ces mini-fleurs peuvent être
toutes identiques (comme pour les chardons des champs) ou différentes :
dans ce cas, souvent, celles du centres sont en forme de petits tubes
réguliers (jaunes dans le cas de la marguerite. On les appelle des
fleurs tubulées), et celles du tour sont souvent beaucoup plus longues
d’un côté du tube (blanches dans le cas de la marguerite. On les appelle
des fleurs ligulées). A noter : lors de la dénomination des couleurs de
fleurs, ce sont ces dernières que nous avons pris comme référence de
couleur (donc blanc dans le cas de la marguerite).
- Corymbe :
le haut de la tige se ramifie, et chaque ramification porte des fleurs,
qui se retrouvent au final à peu près toutes au même niveau, en formant
un plateau. Si les ramifications partent de points différents, on parle
de corymbe (cas de l’achillée millefeuille). Voir la différence avec
l’ombelle.
- Dioïque :
il existe des plantes mâles, qui portent les fleurs mâles qui produiront
du pollen grâce à leurs étamines, et des plantes femelles, qui elles,
portent des fleurs femelles contenant les ovules, qui se transformeront
en fruits et graines si une fécondation a pu avoir lieu (grâce au vent,
aux insectes…). Parmi les plantes cultivées, c’est le cas par exemple
des kiwis : si vous souhaitez un jour avoir des fruits, il vous faudra
planter au minimum un pied mâle et un pied femelle, à moins qu’un voisin
proche n’ait la plante qui vous manque dans son propre jardin, les
abeilles ne s’embarrassant pas des titres de propriété.
- Epi :
toutes les fleurs sont disposées autour d’un axe central, à l’extrémité
de celui-ci (par exemple, la salicaire)
- Epillet :
terme utilisé pour les fleurs de Poacées (anciennement graminées) qui
sont un peu particulières, protégées par des bractées. C’est la façon
dont sont regroupés ces épillets qui aide beaucoup à la reconnaissance
de ces plantes. Quand la plante se dessèche, ces épillets peuvent se
détacher et s’accrocher dans les vêtements ou les pelages d’animaux, ce
qui peut devenir problématique s’ils sont durs et pénètrent dans la
peau…
- Foliole :
une feuille est normalement composée d’une partie plate plus ou moins
grande, plus ou moins découpée : le limbe. Parfois, celui-ci est
tellement découpé qu’on a l’impression de feuilles indépendantes. C’est
celles-ci qu’on appelle folioles. Reconnaitre feuille et foliole ?
Facile ! A la base d’une feuille, là où elle s’attache sur la tige, il y
a toujours un bourgeon (même très petit). Il n’y en a jamais à la base
de folioles. Exemples de plantes à folioles : le fraisier, le pois,
l’acacia et bien d’autres….
- Grappe :
les fleurs sont disposées autour d’un axe, mais chacune à distance des
autres grâce à un pédicelle (« queue »). Tout le monde connait la grappe
de raisin ! Le modèle est le même.
- Médicinale :
plante ayant des propriétés intéressantes pour traiter certaines
affections. Attention : elles peuvent également être toxiques !
- Mellifère :
plante très appréciée par les abeilles pour la fabrication de miel, mais
également par d’autres insectes (papillons…).
- Ombelle :
le haut de la tige se ramifie, et chaque ramification porte des fleurs,
qui se retrouvent au final à peu près toutes au même niveau, en formant
un plateau. Si toutes les ramifications partent du même point, on parle
d’ombelle (cas de la carotte sauvage), ce qui a donné l’ancien nom de la
famille : ombellifères. Voir la différence avec le corymbe.
- Panicule :
c’est un groupe de fleurs non serrées, disposées de façon irrégulière,
dont chaque ensemble peut-être lui-même une grappe, par exemple. On
utilisera ce terme surtout dans le cas des poacées (graminées).
- Rosette :
c’est un cercle de feuilles qu’on trouve à la base de la tige. Vous
pouvez en voir une photo sur la fiche de la Vipérine.
- Sessile
: se dit d’une feuille ou d’une fleur qui n’est pas rattachée à la tige
par une « queue » (appelée pédoncule pour les fleurs, pétiole pour les
feuilles).
- Stolon :
c’est un rejet rampant qui porte des bourgeons à partir desquels il peut
fabriquer des racines, puis une petite plante qui pourra vivre de façon
indépendante une fois suffisamment développée. Bien connu dans le cas
des fraisiers cultivés, par exemple.
- Vivace :
elle vit plus de 2 saisons, et se maintient en place d’une année sur
l’autre. Elle a souvent des tiges plus dures que les plantes annuelles,
des racines implantées plus profondément. L’avantage : d’une année sur
l’autre, on la retrouve au même endroit ! Sauf bien sûr si elle est
coupée trop fréquemment : elle finit par s’affaiblir et disparaitre.
9 septembre 2020,
présentation par Gilles poirier du travail effectué au conseil municipal

Article presse Saumur-Kiosque / 10 septembre 2020

Extrait Courrier de l'Ouest / 15 septembre 2020
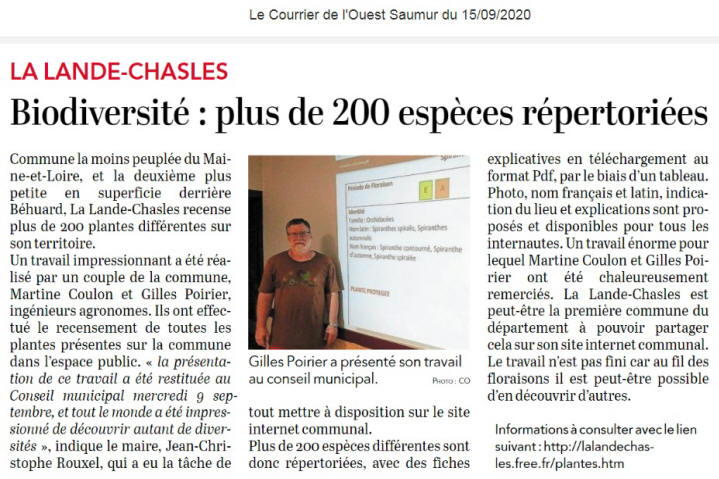

ACCES
TABLEAU / Lien web
Dernière mise à jour / 9 mars 2025